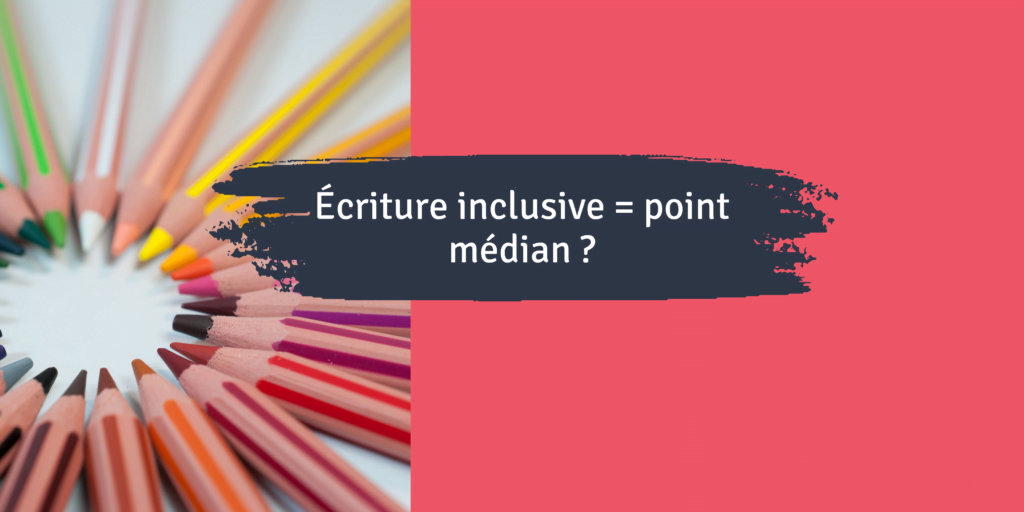Dernièrement, je préparais le contenu écrit d’une story sur Instagram. Je voulais mettre en avant des créateurs et créatrices pour faire de jolis cadeaux à “celles que vous aimez”. Je me relis. Mais, mais… ces cadeaux peuvent être pour des hommes. Je corrige par “à celles et ceux”. Peu convaincue, je remplace par “aux personnes”. Mais, pourquoi, me direz-vous, ne pas avoir choisi “ceux” ? C’est bien connu : en français, c’est le masculin qui l’emporte sur le féminin ! Allez, parlons “écriture inclusive”. Tiens, j’entends des dents grincer dans l’assistance. Promis, je ne parlerai pas que du point médian.
Un peu d’histoire de l’écriture inclusive
La reféminisation de la langue française occupe la sphère publique depuis près de 40 ans. Cela commence par la création de la Commission de féminisation des noms de métier et de fonction en 1984. Le travail de cette commission, présidée par Benoîte Groult – grande figure du féminisme en France, aboutit à la circulaire du 11 mars 1986 qui souhaite imposer la reféminisation des noms de métier, de fonction, de titre et de grade dans l’ensemble des documents de l’administration.
Cette circulaire s’attire l’ire de l’Académie française et tombe dans les oubliettes. Il faudra attendre les années 2010 pour que la reféminisation des noms de métiers ne crée plus aucune polémique. En fait, si…
Régulièrement, l’Assemblée nationale ou le Sénat servent de tribune pour certaines figures politiques qui souhaitent remettre en cause la reféminisation des titres. Par exemple, en novembre 2018, Brune Poirson, alors secrétaire d’État à l’Écologie, reprend Gérard Longuet, sénateur LR. Ce dernier, pour s’adresser à elle, avait commencé son intervention en disant « Madame le Ministre ». Cette situation s’est reproduite en 2021 dans la bouche de Julien Aubert.
Point médian, double flexion, épicène et autres pratiques
Aujourd’hui, la remise en cause de la reféminisation des métiers et des fonctions tient plus de la provocation. Les polémiques se sont déplacées vers l’usage des formes féminisées de la langue française.
La double flexion
La double flexion la plus connue, nous la devons au général de Gaulle : “Françaises, Français”. C’est d’ailleurs lui qui l’a utilisée le premier. Cette double flexion, parfois jugée agaçante à la lecture, consiste à écrire chaque terme non neutre au féminin ET au masculin. Pour l’ordre alphabétique de ces mots, je vous explique tout plus loin 😉
Les termes épicènes
Plus fluide et agréable que la double flexion, le mot “épicène” désigne un terme qui peut être employé indifféremment au féminin ou au masculin :
- élèves pour étudiantes et étudiants
- membres pour adhérentes et adhérents
- population pour habitantes et habitants
Le point médian
Point de crispation, le point médian apparaît à la fin des années 2000. Il permet de remplacer les parenthèses pour encadrer un e. Comme il ne signifie rien d’autre que l’abréviation pour citer les 2 genres, il n’a pas le double de sens de “mettre entre parenthèses”.
Ses détracteurs le disent imprononçable. Pourtant, sa vocation première n’est pas d’être dit à l’oral. En effet, on écrit “étudiant·e” et on prononce “étudiant et étudiante”. D’autres trouvent que c’est trop difficile à écrire. Pourtant, il y a un raccourci clavier facile pour l’utiliser : Alt+250.
Depuis la circulaire de 2017, le point médian est officiellement interdit dans les documents édités par l’État. Néanmoins, son usage s’est démocratisé ces dernières années. On peut le voir dans de nombreuses offres d’emploi sur LinkedIn ou sur Welcome to the Jungle.
L’accord de proximité
La règle de grammaire la plus connue est celle “du masculin qui l’emporte sur le féminin”. Comme elle a pu m’agacer… Enfant, je ne comprenais pas son origine et personne n’était capable de me l’expliquer. Je devais l’appliquer et c’est tout !
Cette règle va s’imposer dans la grammaire française à partir de la fin du XVIIe siècle. Selon le grammairien Nicolas Beauzée, “le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle”. Tout est dit…
Pourtant, cette règle n’a pas toujours été employée en français. Longtemps, comme le grec et le latin, nous pratiquions l’accord de proximité, c’est-à-dire que nous accordions l’adjectif avec le nom le plus proche (cette recommandation est rarement employée).
Les filles et les garçons sont grands.
Mes oncles et tantes sont absentes.
L’ordre alphabétique
L’ordre de mention en français est toujours le même : l’homme est nommé en premier, sauf dans l’expression “mesdames et messieurs” (ou dans “Françaises, Français” !). Par exemple, dans un couple hétérosexuel, cela ne viendrait à l’idée de personne de “femme et mari” 😉.
En écriture inclusive, la recommandation est d’énumérer les éléments par ordre alphabétique (soit au début du mot, soit à la fin du mot) :
- Aurélie et Pierre
- Pierre et Sandrine
- étudiantes et étudiants
- chercheurs et chercheuses
- égalité femme-homme
Dans les faits, ces solutions ne peuvent pas toutes être utilisées en même temps au risque d’avoir un contenu chaotique. Ce sont surtout des recommandations. Il faut donc les adapter en fonction des situations et, toujours, garder à l’esprit que le plus important est de produire un contenu compréhensible pour tous et toutes ou (tous·tes !). J’en profite pour préciser que l’écriture inclusive ne s’utilise que pour désigner des humains. Donc pas de panique : si vous parlez de chaises et de tabourets, vous n’avez pas à appliquer toutes ces recommandations !
Et si on tentait le féminin générique ?
Positionnement politique, réalité à manipuler (il y a des femmes et des hommes), vision binaire de la société ? En fait, le genre féminin est difficile à manipuler en grammaire. Cela va au-delà d’ajouter un e à la fin des mots : l’écriture inclusive ne rend donc pas plus difficile ce point de la grammaire française.
En fait, l’idée n’est pas d’imposer l’écriture inclusive. Ce sont les locuteurs et locutrices qui vont s’en emparer. Finalement, nous savons tous et toutes de quoi nous parlons. D’ailleurs, cela ne dérange personne qu’il y ait deux écritures pour clé/clef 😉.
Dans son livre Ateliers d’écriture, Martin Winckler écrit “Dans ce texte, comme dans L’École des soignantes, j’utiliserai aussi toujours le féminin pluriel pour désigner les personnes qui étudient (étudiantes), écrivent (écrivantes), lisent (lectrices), m’envoient des messages (correspondantes) ou s’inscrivent à mes ateliers (participantes). Ce n’est pas plus arbitraire que d’utiliser le masculin pluriel.”
Si le sujet vous passionne, je vous recommande quelques sources pour cheminer sur l’usage de l’écriture inclusive :
- Parler comme jamais — épisode 14 Écriture inclusive : pourquoi tant de haine ?
- Parler comme jamais — en pratique Faut-il démasculiner notre cerveau ?
- Hoedt et Piron : Tu parles ! — Il n’y a qu’une langue, une grammaire, une République
- Linguisticae — IEL : le pronom de trop ?
- Linguisticae — L’écriture inclusive bientôt interdite ?
- Linguisticae — 10 trucs soûlants autour de l’écriture inclusive
Je vous recommande aussi l’excellent livre sorti en mars 2023 L’écriture inclusive, et si on s’y mettait ? : il vous donnera les clés pour comprendre les enjeux de cette écriture et pour l’appliquer facilement dans vos écrits.
À l’origine, cet article a été rédigé pour l’une de mes newsletters. Au vu des retours positifs sur ce contenu, j’ai eu l’envie de le partager sur mon blog. Je suis convaincue que nous pouvons tous et toutes adopter l’écriture inclusive si on en comprend qu’elle ne se limite pas au seul point médian. Si vous avez envie de suivre mon actualité ou de découvrir les sujets qui m’animent, vous n’avez qu’un seul clic à faire…